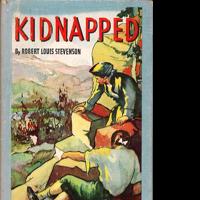Chapitre 15
XV. Le garçon au bouton d'argent à travers l'île de Mull Le Ross de Mull, sur lequel je venais d'arriver, était raboteux et sans chemin frayé, juste comme l'île que je venais de quitter : ce n'était que boue, bruyère et grosses pierres. Il y a peut-être des routes dans ce pays, pour ceux qui le connaissent bien ; mais, pour ma part, je n'avais d'autre flair, ni d'autre point de ralliement que Ben More. Je me dirigeai tant bien que mal sur la fumée que j'avais vue si souvent de l'île ; ma fatigue extrême et les difficultés du chemin m'empêchèrent d'atteindre avant cinq ou six heures du soir la maison au fond du petit creux. Elle était basse et allongée, recouverte de gazon et bâtie en pierre sans mortier ; et devant, sur un tertre, un vieux gentleman était assis, fumant sa pipe au soleil.
Grâce au peu d'anglais qu'il savait, il me fit comprendre que mes compagnons de bord étaient arrivés à terre sains et saufs, et qu'ils avaient cassé la croûte dans cette maison même. – Y en avait-il un, demandai-je, vêtu comme un gentilhomme ?
Il me répondit que tous portaient de grands surtouts grossiers ; toutefois, celui qui était venu seul portait culottes et bas, tandis que les autres avaient des pantalons de matelots.
– Ah ! dis-je, et il avait sans doute aussi un chapeau à plume ?
Il me répondit que non, et qu'il était nu-tête, comme moi. Je crus d'abord qu'Alan avait perdu son chapeau ; mais ensuite je me souviens de la pluie, et jugeai plus vraisemblable qu'il l'avait mis à l'abri sous son surtout. L'idée me fit sourire, tant parce que mon ami était sauvé, qu'à cause de sa fatuité en matière de costume. Mais le vieux gentleman, se frappant le front, s'écria que je devais être le garçon au bouton d'argent. – Mais oui, répondis-je, un peu étonné.
– Eh bien, alors, dit le vieux gentleman, je suis chargé de vous dire que vous devez rejoindre votre ami dans son pays, près de Torosay.
Il me demanda ensuite comment je m'en étais tiré, et je lui contai mon histoire. Un homme du sud aurait certainement ri ; mais ce vieux gentleman (je l'appelle ainsi à cause de ses manières, car il n'avait que des loques sur le dos) m'écouta jusqu'au bout sans manifester autre chose qu'une compassion sérieuse. Quand j'eus fini, il me prit par la main, m'introduisit dans sa cahute (c'est le mot) et me présenta à sa femme comme si elle eût été la reine et moi un duc. La bonne ménagère posa devant moi un pain d'avoine et un coq de bruyère froid, tout en me tapotant l'épaule et me souriant, car elle ne savait pas l'anglais ; et le vieux gentleman (pour ne pas être en reste) me fit un punch très fort de leur eau-de-vie locale. Tout le temps que je mangeai, et ensuite en buvant le punch, je pouvais à peine croire à mon bonheur ; et la maison, bien qu'elle fût obscurcie par la fumée de la tourbe et pleine de trous comme une écumoire, me faisait l'effet d'un palais. Le punch me procura une forte transpiration et un sommeil sans rêves ; les bonnes gens me laissèrent dormir ; et il était près de midi, le lendemain, lorsque je repris la route, la gorge déjà en meilleur état, et mon courage tout à fait restauré par le bon gîte et les bonnes nouvelles. J'eus beau presser le vieux gentleman, il ne voulut pas accepter d'argent, et il me donna même un vieux bonnet pour me couvrir la tête ; mais je reconnais volontiers que je ne fus pas plus tôt hors de vue de sa maison, que je lavai soigneusement ce cadeau dans une fontaine au bord de la route. Et je me disais : « Si ce sont là les sauvages Highlanders, je souhaiterais voir mes compatriotes aussi sauvages. Non seulement j'étais parti tard, mais je dus me fourvoyer la moitié du chemin. À la vérité, je rencontrai beaucoup de gens, grattant leurs misérables carrés de terre incapables de nourrir un chat, où paissaient des vaches minuscules, de la taille à peu près d'un baudet. Le costume du Highland étant interdit par la loi depuis la rébellion, et le peuple condamné au vêtement des basses-terres, qu'il détestait, la variété des accoutrements faisait un curieux spectacle. Les uns allaient nus, à part un paletot flottant ou surtout, et portaient leur pantalon sur l'épaule comme un fardeau inutile ; d'autres s'étaient confectionné un simulacre de tartan avec d'étroites bandes d'étoffe bigarrée cousues ensemble comme un couvre-pied de vieille femme ; d'autres encore portaient toujours le philabeg[24] du Highland, mais, à l'aide de quelques points faufilés entre les jambes, l'avaient métamorphosé en une sorte de pantalon hollandais. Tous ces déguisements étaient prohibés et punis, car on appliquait la loi avec sévérité, dans l'espoir de briser l'esprit de clan ; mais dans cette île perdue au bout du monde, il y avait peu de gens pour y faire attention, et encore moins pour l'aller raconter. Tous semblaient être dans une grande pauvreté ; chose sans doute naturelle, à présent que l'on avait mis fin à la rapine, et que les chefs ne tenaient plus table ouverte. Les routes (jusqu'à cette piste rustique et sinueuse que je suivais) étaient infestées de mendiants. Et là encore je notai une différence avec la partie du pays où j'étais né. Car nos mendiants du Lowland – même ceux en robe, patentés – avaient une manière à eux de basse flagornerie, et si vous leur donniez un patard, en réclamant la monnaie, ils vous rendaient poliment un liard. Mais ces mendiants du Highland se drapaient dans leur dignité, ne demandaient l'aumône que pour acheter de la prise (à leur dire) et ne rendaient pas la monnaie. À coup sûr, je ne m'en souciais guère, à part l'intérêt que cela m'offrait chemin faisant. Mais ce qui m'ennuyait davantage, peu de gens savaient l'anglais, et ceux-là (à moins qu'ils ne fussent de la confrérie des mendiants) n'étaient guère désireux de mettre leur anglais à mon service. Je savais que j'allais à Torosay, et je leur redisais le mot avec un geste d'interrogation ; mais au lieu d'un geste de réponse, ils me répliquaient par une kyrielle de gaélique qui m'ahurissait ; il n'y a donc rien d'étonnant si je déviai de la bonne route aussi souvent que je la suivais. Enfin, vers huit heures du soir, et déjà recru de fatigue, j'arrivai à une maison isolée où je demandai l'hospitalité. Je venais d'essuyer un refus, lorsque je m'avisai de la puissance de l'argent dans un pays aussi pauvre, et présentai une de mes guinées entre le pouce et l'index. Aussitôt, l'homme de la maison, qui avait jusque-là fait semblant d'ignorer l'anglais et m'avait chassé de son seuil par gestes, se mit à parler aussi clairement qu'il en était besoin, et consentit, moyennant cinq shillings, à me donner le gîte pour la nuit et à me guider le lendemain jusqu'à Torosay. Je dormis mal cette nuit-là, dans la crainte d'être volé ; mais je n'avais pas besoin d'avoir peur, car mon hôte n'était pas larron, mais simplement très pauvre et des plus fourbes. Il n'était pas seul dans sa pauvreté, car le matin il nous fallut faire environ cinq milles jusqu'à la maison de ce qu'il appelait un riche homme pour changer une de mes guinées. Ce riche l'était peut-être pour Mull ; on ne l'aurait guère jugé tel dans le sud ; car il dut réunir toutes ses richesses, – la maison fut retournée de fond en comble et un voisin mis à contribution, avant de parfaire une somme de vingt shillings en argent. Le shilling de reste, il le garda pour lui, soutenant qu'il oserait à peine avoir chez lui « sous clef » une somme aussi importante. D'ailleurs, il se montra fort poli et bien élevé, nous fit asseoir tous deux avec sa famille pour dîner et prépara du punch dans un beau saladier de porcelaine, ce qui réjouit mon coquin de guide à un point tel qu'il ne voulut plus repartir. J'étais prêt à me mettre en colère, et pris à témoin le riche homme (il s'appelait Hector Maclean) qui venait d'assister à notre marché et au paiement des cinq shillings. Mais Maclean avait pris sa part du punch et il jura qu'aucun gentleman ne quitterait sa table une fois le saladier préparé. Il ne me resta plus qu'à me rasseoir et à écouter des toasts jacobites et des chants gaéliques, jusqu'à l'heure où tout le monde fut ivre et où chacun s'alla coucher dans son lit ou dans la grange. Le jour suivant (quatrième de mes pérégrinations) nous fûmes sur pied avant cinq heures ; mais mon coquin de guide se remit aussitôt à boire, car il était trois heures quand je parvins à le faire sortir de la maison, et cela (comme on va le voir) pour aboutir à un autre désagrément.
Aussi longtemps que nous descendîmes un val de bruyère qui s'allongeait devant la maison de M. Maclean, tout alla bien ; si ce n'est que mon guide regardait sans cesse derrière lui, et lorsque je lui demandais pourquoi, il me répondait par une grimace. Mais à peine avions-nous franchi la crête d'une colline et perdu de vue les fenêtres de la maison, il me dit que j'avais Torosay juste devant moi et qu'un sommet (qu'il me désigna) était mon meilleur repère. – Peu m'importe, dis-je, puisque vous venez avec moi. L'impudent fourbe me répondit en gaélique qu'il ne savait pas l'anglais. – Mon bon ami, dis-je, je m'aperçois que votre anglais va et vient facilement. Dites-moi ce qui pourrait le ramener. Est-ce encore de l'argent qu'il vous faut ? – Cinq shillings de plus, dit-il, et je vous y conduis.
Après quelque réflexion, je lui offris deux, qu'il s'empressa d'accepter, mais il tint absolument à les avoir en main tout de suite, – « pour la chance », comme il disait, bien que ce fût plutôt pour le malheur. Les deux shillings ne le menèrent pas beaucoup plus loin qu'un nombre égal de milles, au bout desquels il s'assit au bord de la route et retira ses brogues[25] de ses pieds comme pour se reposer. J'étais à présent chauffé au rouge. – Ha ! dis-je ; vous ne savez plus l'anglais ? Il me répondit cyniquement :
– Non.
Ma colère déborda, et je levai la main pour le frapper. Lui, tirant un couteau de dessous ses haillons, se ramassa sur lui-même en soufflant comme un chat irrité. Alors, emporté par ma colère, je m'élançai sur lui, détournai son couteau de la main gauche et le frappai de mon poing droit sur la bouche. J'étais un garçon robuste et très en colère et lui un tout petit homme : il tomba pesamment à mes pieds. Par bonheur, il lâcha son couteau dans sa chute.
Je le ramassai, ainsi que les brogues, lui souhaitai le bonjour, et me remis en route, le laissant pieds nus et désarmé. Je riais tout seul, chemin faisant, car j'étais assuré d'en avoir fini avec le drôle, pour plusieurs raisons. D'abord, il savait bien qu'il n'aurait plus de mon argent ; puis les brogues ne valaient guère dans ce pays que quelques sous ; et enfin, le couteau, – en réalité un poignard, – était de port interdit par la loi. Après une demi-heure de marche environ, je rattrapai un homme grand, déguenillé, qui allait assez vite, mais en tâtant devant lui avec un bâton. C'était un aveugle ; et il me raconta qu'il était catéchiste, ce qui eût dû me rassurer. Mais sa physionomie me prévenait contre lui : elle était sombre, menaçante et fausse ; et, de plus, je vis l'acier d'une crosse de pistolet dépasser le rabat de sa poche de paletot. Le port de cet objet entraînait une amende de quinze livres sterling à la première contravention, et la déportation aux colonies en cas de récidive. Je ne voyais pas non plus très bien la nécessité d'être armé pour enseigner la religion, ni ce qu'un aveugle pouvait faire d'un pistolet. Je lui racontai mes démêlés avec mon guide, car j'étais fier de mon exploit, et ma vanité fut plus forte que ma prudence. La mention des cinq shillings le fit se récrier si haut que je résolus de passer les deux autres sous silence, et me félicitai de ce qu'il ne pût me voir rougir. – C'était donc trop, demandai-je, assez penaud. – Trop ! s'écria-t-il. Hé quoi, je vous guiderai moi-même jusqu'à Torosay pour un coup d'eau-de-vie. Et vous aurez le plaisir de ma société (celle d'un homme instruit) par-dessus le marché. Je lui répondis que je ne voyais pas très bien comment un aveugle pouvait servir de guide ; mais il se mit à rire et dit que son bâton valait pour lui des yeux d'aigle, ajoutant : – Dans l'île de Mull, en tout cas, où je connais par cœur chaque pierre et chaque buisson de bruyère. Ainsi tenez, dit-il en agitant son bâton de droite et de gauche comme pour s'en assurer, – par là-bas coule un torrent, et il provient de cette petite colline qui a sur son sommet une pierre penchée ; et c'est juste au pied de cette colline que passe la route de Torosay ; et le chemin où nous sommes, destiné aux troupeaux, est tout piétiné, tandis que l'herbe y pousse, à la traversée de la lande. Je dus reconnaître qu'il avait raison de tous points, et lui avouai mon étonnement. – Ha ! dit-il, ceci n'est rien. Croiriez-vous qu'avant la promulgation de la loi, et quand on avait des armes dans le pays, je savais tirer. Oui, je savais ! s'écria-t-il, puis, d'un air sournois : – Si j'avais quelque chose qui ressemblât à un pistolet, je vous montrerais comment je fais. Je lui répondis que je n'avais rien de ce genre, et m'écartai de lui davantage. Il ne savait pas que son pistolet dépassait alors très visiblement de sa poche, et que je voyais reluire au soleil l'acier de la crosse. Mais par bonheur pour moi, il n'en savait rien, et, se figurant que l'arme était cachée, il mentait effrontément. Il se mit ensuite à me poser des questions insidieuses, pour savoir d'où je venais, si j'étais riche, si je pouvais lui changer une pièce de cinq shillings (qu'il avait à cette heure même dans sa poche, affirmait-il) ; et cependant il ne cessait d'appuyer dans ma direction, tandis que je m'efforçais de l'éviter. Nous cheminions alors sur une sorte de piste à bestiaux herbeuse, qui franchissait les collines vers Torosay, et nous changions de côté sans arrêt, tels des danseurs dans un chassé-croisé. J'avais si clairement le dessus que je m'enhardis, et pris un réel plaisir à ce jeu de colin-maillard ; mais le catéchiste se mettait plus en colère à mesure, et finalement il lança des jurons en gaélique et s'efforça de m'envoyer son bâton dans les jambes. Alors je lui annonçai qu'à vrai dire j'avais un pistolet tout comme lui, et que s'il n'obliquait pas vers le sud à travers la colline, je lui ferais sauter la cervelle. Il devint aussitôt des plus polis ; et après avoir un moment tâché de m'amadouer, sans succès, il me maudit une fois de plus en gaélique, et s'éloigna. Je suivis du regard ses enjambées parmi les flaques et la bruyère, qu'il tapotait avec son bâton, jusqu'à ce qu'il eût tourné le bout d'une colline et disparu dans le prochain creux. Puis je me remis en route vers Torosay, trouvant bien plus agréable d'être seul que de voyager avec cet homme de savoir. J'avais joué de malheur, ce jour-là, car ces deux hommes dont je venais de me débarrasser, l'un après l'autre, étaient les pires que je rencontrai jamais dans les Highlands. À Torosay, sur le Sound de Mull et orientée vers la terre ferme de Morven, il y avait une auberge dont le patron était un Maclean, et, paraît-il, de très grande famille ; car dans les Highlands plus que chez nous encore, on estime que tenir une auberge est un métier distingué, à cause peut-être qu'il participe de l'hospitalité, ou encore parce qu'on y est ivrogne et fainéant. Il parlait bien anglais, et découvrant que j'avais quelque instruction, m'essaya d'abord en français, où il me battit sans peine, puis en latin, où nous fûmes, je crois, égaux. Cet agréable tournoi nous mit dès l'abord sur un pied amical ; et je m'assis à boire du punch avec lui (ou, pour être plus exact, je m'assis et le regardai boire) tant qu'il fut ivre au point de pleurer sur mon épaule. Comme sans y songer, je lui montrai, pour voir, le bouton d'Alan ; mais je me rendis compte qu'il ne l'avait ni vu ni connu. D'ailleurs, il avait quelque grief contre la famille et les amis d'Ardshiel, et avant d'être ivre, il me lut une satire, en très bon latin, mais des plus mordantes, qu'il avait composée en vers élégiaques contre une personne de ce nom. Quand je lui parlai de mon catéchiste, il branla la tête, et me dit que j'avais eu de la chance de m'en dépêtrer. – C'est un homme des plus dangereux, dit-il, que ce Duncan MacKrieg ; il sait tirer au jugé à plusieurs yards, et on l'a souvent accusé de vols sur les grands chemins, et une fois même d'assassinat. – Mais le bouquet, dis-je, c'est qu'il se prétend catéchiste. – Et pourquoi pas ? répliqua mon hôte. Il l'est bien en effet. C'est Maclean de Duart qui l'a nommé à ces fonctions, à cause de son infirmité. Mais peut-être est-ce regrettable, car il est toujours par les routes, allant d'un endroit à un autre pour faire réciter leur catéchisme aux jeunes personnes ; et sans nul doute, c'est pour le pauvre diable une grande tentation. Finalement, lorsqu'il fut incapable de boire davantage, notre homme me conduisit à un lit, où je me couchai d'excellente humeur, ayant traversé la plus grande partie de cette longue et recourbée île de Mull, d'Earraid à Torosay, et fait cinquante milles à vol d'oiseau, mais (vu mes erreurs) beaucoup plus près de cent, en quatre jours et sans trop de fatigue. Du reste, je me trouvais en bien meilleures dispositions, de corps et d'esprit, au bout de cette longue marche, que je ne l'étais au commencement.