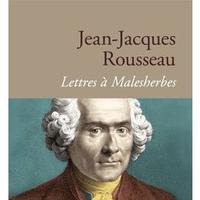TROISIEME LETTRE.
Montmorenci le 26 Janvier 1762.
Après vous avoir exposé, Monsieur, les vrais motifs de ma conduite, je voudrois vous parler de mon état moral dans ma retraite ; mais je sens qu'il est bien tard, mon ame aliénée d'elle-même est toute à mon corps. Le délabrement de ma pauvre machine l'y tient de jour en jour plus attachée, & jusqu'à ce qu'elle s'en sépare enfin tout-à-coup. C'est de mon bonheur que je voudrois vous parler, & l'on parle mal du bonheur quand on souffre. Mes maux sont l'ouvrage de la nature, mais mon bonheur est le mien. Quoi qu'on en puisse dire, j'ai été sage, puisque j'ai été heureux autant que ma nature m'a permis de l'être : je n'ai point été chercher ma félicité au loin, je l'ai cherchée auprès de moi, & l'y ai trouvée. Spartien dit que Similis, courtisan de Trajan ayant sans aucun mécontentement personnel quitté la Cour & tous ses emplois pour aller vivre paisiblement à la campagne, fit mettre ces mots sur sa tombe : j'aidemeuré soixante & seize ans sur la terre, & j'en ai vécu sept. Voilà ce que je puis dire, à quelque égard, quoique mon sacrifice ait été moindre : je n'ai commencé de vivre que le 9 Avril 1756.
Je ne saurois vous dire, Monsieur, combien j'ai été touché de voir que vous m'estimiez le plus malheureux des hommes. Le public sans doute en jugera comme vous, & c'est encore ce qui m'afflige. Ô que le sort dont j'ai joui, n'est-il connu de tout l'univers ! chacun voudroit s'en faite un semblable ; la paix régneroit sur la terre ; les hommes ne songeroient plus à se nuire, & il n'y auroit plus de méchans quand nul n'auroit intérêt à l'être. Mais de quoi jouissois-je enfin quand j'étois seul ? De moi, de l'univers entier, de tout ce qui est, de tout ce qui peut être, de tout ce qu'a de beau le monde sensible, & d'imaginable le monde intellectuel : je rassemblois autour de moi tout ce qui pouvoit flatter mon cœur ; mes desirs étoient la mesure de mes plaisirs. Non, jamais les plus voluptueux n'ont connu de pareilles délices, & j'ai cent fois plus joui de mes chimeres qu'ils ne font des réalités. Quand mes douleurs me font tristement mesurer la longueur des nuits, & que l'agitation de la fievre m'empêche de goûter un seul instant de sommeil, souvent je me distrais de mon état présent en songeant aux divers événemens de ma vie ; & les repentirs, les doux souvenirs, les regrets, l'attendrissement se partagent le soin de me faire oublier quelques momens mes souffrances. Quels tems croiriez-vous, Monsieur, que je me rappelle le plus souvent & le plus volontiers dans mes rêves ? Ce ne sont point les plaisirs de ma jeunesse, ils furent trop rares, trop mêlés d'amertumes, & sont déjà trop loin de moi. Ce sont ceux de ma retraite, ce sont mes promenades solitaires, ce sont ces jours rapides mais délicieux que j'ai passés tous entiers avec moi seul, avec ma bonne & simple gouvernante, avec mon chien bien aimé, ma vieille chatte, avec les oiseaux de la campagne & les biches de la forêt ; avec la nature entiere & son inconcevable Auteur. En me levant avant le soleil pour aller voir, contempler son lever dans mon jardin ; quand je voyois commencer une belle journée, mon premier souhait étoit que ni lettres, ni visites n'en vinssent troubler le charme. Après avoir donné la matinée à divers soins que je remplissois tous avec plaisir, parce que je pouvois les remettre à un autre tems, je me hâtois de dîner pour échapper aux importuns, & me ménager un plus long après-midi. Avant une heure, même les jours les plus ardens, je partois par le grand soleil avec le fidelle achate, pressant le pas dans la crainte que quelqu'un ne vînt s'emparer de moi, avant que j'eusse pu m'esquiver ; mais quand une fois, j'avois pu doubler un certain coin, avec quel battement de cœur, avec quel pétillement de joie je commençois à respirer en me sentant sauve, en me disant, me voilà maître de moi pour le reste de ce jour ! J'allois alors d'un pas plus tranquille chercher quelque lieu sauvage dans la forêt, quelque lieu désert où rien ne montrant la main des hommes, n'annonçât la servitude & la domination, quelque asyle où je pusse croire avoir pénétré le premier, & où nul tiers importun ne vînt s'interposer entre la nature & moi. C'étoit là qu'elle sembloit déployer à mes yeux une magnificence toujours nouvelle. L'or des genêts, & la pourpre des bruyeres frappoient mes yeux d'un luxe qui touchoit mon cœur ; la majesté des arbres qui me couvroient de leur ombre, la délicatesse des arbustes qui m'environnoient, l'étonnante variété des herbes & des fleurs que je foulois sous mes pieds, tenoient mon esprit dans une alternative continuelle d'observation & d'admiration : le concours de tant d'objets intéressans qui se disputoient mon attention, m'attirant sans cesse de l'un à l'autre, favorisoit mon humeur rêveuse & paresseuse, & me faisoit souvent redire en moi-même ; non, Salomon dans toute sa gloire ne fut jamais vêtu comme l'un d'eux. Mon imagination ne laissoit pas long-tems déserte la terre ainsi parée. Je la peuplois bientôt d'êtres selon mon cœur, & chassant bien loin l'opinion, les préjugés, toutes les passions factices, je transportois dans les asyles de la nature, des hommes dignes de les habiter. Je m'en formois une société charmante dont je ne me sentois pas indigne, je me faisois un siecle d'or à ma fantaisie, & remplissant ces beaux jours de toutes les scenes de ma vie, qui m'avoient laissé de doux souvenirs, & de toutes celles que mon cœur pouvoit desirer encore, je m'attendrissois jusqu'aux larmes sur les vrais plaisirs de l'humanité, plaisirs si délicieux, si purs, & qui sont désormais si loin des hommes. Ô si dans ces momens quelque idée de Paris, de mon siecle, & de ma petite gloriole d'Auteur, venoit troubler mes rêveries, avec quel dédain je la chassois à l'instant pour me livrer sans distraction, aux sentimens exquis dont mon ame étoit pleine ! Cependant au milieu de tout cela, je l'avoue, le néant de mes chimeres venoit quelquefois la contrister tout-à-coup. Quand tous mes rêves se seroient tournés en réalités, ils ne m'auroient pas suffi ; j'aurois imaginé, rêvé, desiré encore. Je trouvois en moi un vide inexplicable que rien n'auroit pu remplir ; un certain élancement de cœur vers une autre sorte de jouissance dont je n'avois pas d'idée, & dont pourtant je sentois le besoin. Hé bien, Monsieur, cela même étoit jouissance, puisque j'en étois pénétré d'un sentiment très-vif & d'une tristesse attirante, que je n'aurois pas voulu ne pas avoir. Bientôt de la surface de la terre, j'élevois mes idées à tous les êtres de la nature, au systême universel des choses, à l'Être incompréhensible qui embrasse tout. Alors l'esprit perdu dans cette immensité, je ne pensois pas, je ne raisonnois pas, je ne philosophois pas ; je me sentois avec une sorte de volupté accablé du poids de cet univers, je me livrois avec ravissement à la confusion de ces grandes idées, j'aimois à me perdre en imagination dans l'espace, mon cœur resserré dans les bornes des êtres s'y trouvoit trop à l'étroit, j'étouffois dans l'univers, j'aurois voulu m'élancer dans l'infini. Je crois que si j'eusse dévoilé tous les mysteres de la nature, je me serois senti dans une situation moins délicieuse, que cette étourdissante extase à laquelle mon esprit se livroit sans retenue, & qui dans l'agitation de mes transports, me faisoit écrier quelquefois, ô grand Être ! ô grand Être ! sans pouvoir dire, ni penser rien de plus.
Ainsi s'écouloient dans un délire continuel, les journées les plus charmantes que jamais créature humaine ait passées ; & quand le coucher du soleil me faisoit songer à la retraite, étonné de la rapidité du tems, je croyois n'avoir pas assez mis à profit ma journée, je pensois en pouvoir jouir davantage encore, & pour réparer le tems perdu, je me disois ; je reviendrai demain. Je revenois à petit pas, la tête un peu fatiguée, mais le cœur content ; je me reposois agréablement au retour, en me livrant à l'impression des objets, mais sans penser, sans imaginer, sans rien faire autre chose, que sentir le calme & le bonheur de ma situation. Je trouvois mon couvert mis sur ma terrasse. Je soupois de grand appétit dans mon petit domestique, nulle image de servitude & de dépendance ne troubloit la bienveillance qui nous unissoit tous. Mon chien lui-même étoit mon ami, non mon esclave, nous avions toujours la même volonté, mais jamais il ne m'a obéi ; ma gaîté durant toute la soirée témoignoit que j'avois vécu seul tout le jour ; j'étois bien différent quand j'avois vu de la compagnie, j'étois rarement content des autres, & jamais de moi. Le soir j'étois grondeur & taciturne : cette remarque est de ma gouvernante, & depuis qu'elle me l'a dite, je l'ai toujours trouvée juste en m'observant. Enfin, après avoir fait encore quelques tours dans mon jardin, ou chanté quelque air sur mon épinette, je trouvois dans mon lit un repos de corps & d'ame, cent fois plus doux que le sommeil même. Ce sont là les jours qui ont fait le vrai bonheur de ma vie, bonheur sans amertume, sans ennuis, sans regrets, & auquel j'aurois borné volontiers tout celui de mon existence. Oui, Monsieur, que pareils jours remplissent pour moi l'éternité, je n'en demande point d'autres, & n'imagine pas que je sois beaucoup moins heureux dans ces ravissantes contemplations, que les intelligences célestes. Mais un corps qui souffre, ôte à l'esprit sa liberté ; désormais je ne suis plus seul, j'ai un hôte qui m'importune, il faut m'en délivrer pour être à moi, & l'essai que j'ai fait de ces douces jouissances, ne sert plus qu'à me faire attendre avec moins d'effroi, le moment de les goûter sans distraction. Mais me voici déjà à la fin de ma seconde feuille. Il m'en faudroit pourtant encore une. Encore une lettre donc, & puis plus. Pardon, Monsieur, quoique j'aime trop à parler de moi, je n'aime pas à en parler avec tout le monde, c'est ce qui me fait abuser de l'occasion quand je l'ai, & qu'elle me plaît. Voilà mon tort & mon excuse. Je vous prie de la prendre en gré.